Trois interviews en une seule : qui dit mieux ? Une version considérablement raccourcie de cet entretien datant d’octobre 2018 a été initialement publiée dans le numéro de Whisky Magazine paru en avril 2019. En voici, en exclusivité sur notre site internet, la version longue. Mais ce n’est pas tout ! Elle a été actualisée par une seconde interview, réalisée le 30 mars 2020 par Skype, et ces nouveaux compléments d’information sont indiqués en italique dans le texte. Bonne lecture !
Interviewer Alexandre Gabriel, le créateur des rhums Plantation, est toujours un challenge. Vous arrivez avec un timing, un plan et des questions, et le bougre vous fiche tout en l’air en ferraillant avec passion pendant quatre heures. Une mine d’information ! Inlassable avocat de la diversité du rhum, pourfendeur des dogmes réducteurs, producteur dans l’âme, il revient sur la genèse de Plantation, qui va fêter ses 20 ans, le rachat de West Indies à la Barbade, la révision des règlementations, l’évolution du marché… Sans jamais éviter les questions qui fâchent.
Quelle période folle ! Tu es confiné ?
Oui, on est confinés près de Cognac, à Bonbonnet. On a immédiatement protégé les équipes. Heureusement, chez nous la campagne de distillation du cognac était terminée avant le confinement. On commence Citadelle [le gin, ndlr]. Le distillateur est seul dans la distillerie, on a sécurisé les postes de production. Le travail dans les vignes, ça va, les gens ne sont pas les uns sur les autres. Sur la chaîne d’embouteillage, on travaille à un tiers des cadences pour que les gens restent à 2m les uns des autres, et on fait tourner les équipes. Et on a vidé tous les bureaux, tout le monde télétravaille. Donc, oui, c’est une période folle… Tu sais qu’on travaille beaucoup avec les grands bars partout dans le monde, et ils sont en souffrance totale. J’en ai plusieurs chaque jour au téléphone, c’est très dur, surtout aux Etats-Unis où ils n’ont pas de filets de protection. Moi, j’ai gardé tout le monde, on ne licencie personne, y compris à la Barbade.
Tes distilleries tournent ?
Oui, on manage à vue, avec plein d’incertitudes. A la Barbade, les casernes de pompiers, les hôpitaux nous ont demandé du gel hydro-alcoolique, on redistille des rhums blancs pour faire face à ces demandes. Le Surinam nous a appelé, ils n’ont plus rien non plus. On fait aussi des gels et solutions à Cognac : le BNIC [l’interprofession, ndlr] organise un effort collectif, en partenariat avec un labo. Rien d’héroïque, cela fait du bien au moral de participer à l’effort collectif.

J’imagine que le business fonctionne au ralenti…
Quand les bars, qui sont une partie importante de notre business, sont en souffrance, nous aussi par voie de conséquence. Beaucoup de nos clients sont en difficulté. On venait de sortir deux nouveaux Fidji pour Plantation, un millésime 2009, rustique, non dosé, avec un côté diamant brut, et un Isle of Fiji qu’on trouvera un peu en grande distribution, un assemblage avec 20% de pot still, légèrement dosé, comme si on l’avait gentiment poli, et très abordable, dans les 25-30€. J’adore collaborer avec Fidji [la distillerie South Pacific, ndlr] car au lieu de travailler sur les esters, ils travaillent sur les alcools supérieurs, les notes chocolatées, amères. A part le Guyana, ils sont peu nombreux à faire cela, c’est plus difficile, plus technique. Et pas tout public.
Tu crées Plantation en 1999. Comment, pourquoi ?
Le rhum, c’est un coup de cœur. Je l’ai découvert presque par hasard, lors d’un voyage aux Caraïbes où je comptais vendre mes fûts de cognac d’occasion. J’y allais avec une intention purement mercantile – on était une petite boîte, on avait besoin de cash –, et là, le coup de foudre. Je découvre un produit agricole – parce que quand on parle de spiritueux, on parle d’agriculture et on a tendance à l’oublier –, avec des terroirs, des histoires, des cultures. Ce sont des mots qu’on emploie aujourd’hui à toutes les sauces, mais le rhum est tellement riche de tout cela !
Tu rentres en France et tu commences à élever des rhums dans la foulée ?
Je pars d’abord visiter d’autres îles, j’achète un peu de vrac, et j’entame des recherches à 360°, lisant tout ce que je peux trouver sur le rhum, passé et présent – jusqu’aux trucs les plus fous. J’ai trouvé des ouvrages sur les high esters écrits par les Japonais, par exemple.Je découvre ainsi qu’une partie de l’histoire du rhum, c’est le voyage des fûts qui traversaient les océans en bateau. Donc je me suis dit : pourquoi ne pas perpétuer cette histoire ? Et aujourd’hui encore, quand nous achetons du rhum, nous demandons toujours qu’on nous l’envoie en fûts. L’interaction entre le bois et le liquide, ce vieillissement dynamique, est au maximum pendant le voyage : tu es en milieux humide, et ça bouge tout le temps avec le roulis, pendant deux, trois, quatre mois, six mois parfois, parce que quand tu expédies des fûts de Fidji, ils font pratiquement le tour du monde. On a commencé avec quelques fûts de la Barbade, de Jamaïque et un petit peu de Trinidad. Il y a vingt ans, ce n’était pas si simple de vendre un rhum de terroir, millésimé, pas vraiment calibré pour le rhum-cola – le marché était très différent. Mais ça a décollé, au-delà de nos espérances. A partir de là, une grande partie de nos économies est passée dans le stock, aujourd’hui l’un des plus importants d’Europe en rhums vieux, avec des pièces très rares ou qui n’existent plus, des Long Pond du début des années 80, la dernière distillation de la petite colonne de Long Pond, de vieux pot stills de la Barbade, des vieux Haïtiens… Chez Plantation, il y a plus de 15 expressions, sans compter les single casks : si je bossais dans une grosse boîte, j’aurais été viré depuis longtemps.
Tu vas vraiment sélectionner tous tes rhums chez les producteurs ?
Moi ou mon équipe, absolument. Il m’arrive d’acheter chez les brokers pour compléter, même si ce sont surtout des clients – avec West Indies, Long Pond ou Clarendon.
Il y a quand même une mythologie autour des éleveurs assembleurs qui « courent le monde pour choisir les meilleurs fûts » alors qu’ils font leur marché chez les brokers…
C’est vrai. Nous, à 98% on cherche nous-mêmes. Si une distillerie a un contrat exclusif avec un broker, je choisis directement les fûts avec la distillerie, mais je suis facturé par le broker. J’ai un rapport avec les gens qui font le rhum, soit le distillateur, soit le maître de chai. Liam Costello à Fidji, ça fait quinze ans qu’on discute ensemble en direct. Je connais bien son matériel, car je connais les chaudronniers qui ont fabriqué ses alambics. Il a notamment un pot still John Dore dessiné par David Pym, qui a fait l’un de ceux de Ste Lucie et de Long Pond. Je connaissais très bien les gens de West Indies, et ils sont la première des raisons pour laquelle je me suis intéressé à cette distillerie, avant même le matériel. C’est une distillerie très secrète.
Tu avais espéré racheter Ste Lucia Distillers avant de reprendre West Indies à la Barbade ?
Bien sûr, c’était une distillerie qui m’intéressait beaucoup, pour des raisons émotionnelles, affectives aussi. Mais elle s’est vendue beaucoup trop cher pour nous. Laurie Barnard, l’ancien propriétaire de St Lucia Distillers [décédé en 2012, ndlr], m’a ouvert les portes des Caraïbes, il a eu une grande influence sur mon travail. On partageait la même philosophie. C’était une personnalité emblématique, devenue un mentor pour moi, quelqu’un d’ouvert, d’une curiosité folle, qui détestait les sectaires, dans la vie comme dans la technique. C’est lui qui m’a ouvert la porte des Caraïbes. Il est venu à Cognac, et j’ai passé beaucoup de temps à St Lucie. Il était fasciné par nos techniques d’élevage, moi j’étais fasciné par ses savoir-faire sur la fermentation, la distillation. Parmi ses alambics, lui préférait son Vendôme, moi je préférais son John Dore : le Vendôme fait un rhum presque iodé, le John Dore est le “classic retort” des Caraïbes. Notre premier millésime Plantation, St Lucie 2003, était 100% Vendôme, le 2004 était un assemblage des deux et le 2005 presque 100% du John Dore. Il me reste du stock, quand je vois ces fûts dans les chais, je pense à lui, à ces moments qu’on a passés ensemble, à théoriser l’avenir du rhum, à rêver que le rhum monte en gamme. On se parlait tout le temps, on s’échangeait les savoir comme les gamins s’échangent les cartes de football. Quand sa distillerie a été mise en vente, je me suis dit que c’était un signe. Le destin a voulu les choses différemment [St Lucia Distillers a été reprise par le Groupe Bernard Hayot en 2016, ndlr].
En quoi ta démarche est-elle différente des autres maisons de négoce ? Est-ce que tu te vis comme un négociant d’abord ? Un assembleur ? Un éleveur ?
Je me vis comme un producteur, à Cognac d’abord, dans les Caraïbes aujourd’hui. C’est une aubaine de pouvoir vivre sur deux terroirs. Pour Plantation, on est éleveurs, et distillateurs depuis le rachat de West Indies sur deux origines, Barbade et Jamaïque, qui représentent 65-70% de nos volumes aujourd’hui.
Comment définirais-tu Plantation ?
C’est un terroir qu’on va interpréter. Comme un jazzman part d’un thème. La Jamaïque telle que Plantation la voit est différente de la Jamaïque telle qu’Appleton la voit.
Elle ressemble à quoi, ta Jamaïque ?
Très alambic, avec des fermentations longues, un niveau d’esters assez haut mais pas fou. Tu sais qu’il y a 4 catégories de rhums jamaïcains : les common cleans (jusqu’à 150g d’esters), les plummers, les wedderburn, puis les high esters, qui n’ont jamais été faits pour être bus, ce sont des bonificateurs. Ce qui me plaît, c’est le niveau Plummer, à partir de 150g d’esters. Le Wedderburn offre un moment assez rare de dégustation mais plus difficile, c’est un peu comme écouter de la musique très, très fort : ton corps entier vibre, mais tu fais ça deux heures de temps en temps lors d’un concert, pas tous les jours. Nos Jamaïque sont 100% pot still, ça a été la dernière île à adopter la colonne dans les années 1950.
L’ADN de Plantation, c’est aussi le double vieillissement…
A plusieurs titres. Il y a le double vieillissement sous bois, en chêne américain puis européen, avec différents précédents contenus puisque nos rhums finissent leur maturation en fûts de cognac. Mais aussi un double vieillissement climatique : d’abord sous les tropiques, avec une part des anges importante, une plus faible intégration des tannins à cause des températures stables, puis sur le continent, avec une forte amplitude thermique qui apporte le tranchage, c’est à dire une forte intégration des tannins. Enfin, le vieillissement sur terre ferme et pendant le voyage en mer. Tout cela, ce sont des outils fabuleux pour un maître de chai. Plantation, c’est trois piliers : les terroirs, le double vieillissement, l’élevage.

L’élevage à la cognaçaise, où on ne se contente pas de mettre en fût et d’attendre que le temps passe…
Oui, à Cognac, le vieillissement est proactif : tu goûtes, tu redouelles, tu changes les fonds du fût pour ajuster l’apport tannique en adaptant aussi le toastage, tu choisis un chai humide ou un chai sec, tu décides du taux d’alcool au moment où tu introduis le rhum dans le fût, tu vas faire une petite réduction à un moment donné, non seulement parce que tu ne veux pas que ton spiritueux soit choqué, mais aussi parce qu’en fonction du degré d’alcool tu extrais différents éléments du bois. La vanilline, par exemple, est plus soluble dans l’eau que dans l’alcool : si tu veux extraire plus de vanilline, obtenir un profil assez doux, suave, tu prends un fût de chêne américain, plutôt neuf, et tu réduis à un degré assez faible, 55%, et là tu sortiras des éléments plutôt sucrés du bois. Ça c’est l’élevage. Tu choisis un chai humide, où l’alcool s’évapore plus vite que l’eau, pour arrondir ton spiritueux, le rendre plus suave, plus huileux. Dans un chai sec, l’eau s’évapore plus vite, tu concentres l’alcool. Là, on travaille sur des petits systèmes d’arrosage au sol pour créer une ambiance humide plus maîtrisée. La réduction progressive aussi fait partie de l’élevage, ainsi que les assemblages progressifs, les pré-assemblages que tu maries en foudres avant de les redispatcher en fûts pour obtenir du fondu. Le double-vieillissement est un outil fabuleux pour le maître de chai. Et après il y en a qui te disent : non, il faut vieillir intégralement sous les tropiques. Mais pourquoi ? Pourquoi s’interdire d’autres outils techniques qui apportent d’autres saveurs ? Si tous les rhums étaient faits de la même façon, le travail d’assemblage serait à la fois simple et inintéressant, ils se ressembleraient tous. Les meilleurs maîtres de chai, ce n’est pas un hasard, on les trouve dans les îles où le rhum est le plus diversifié, en Jamaïque par exemple. Tu as tellement de marks avec des personnalités différentes que tu as intérêt à être bon ! Si tu mélanges un rhum avec beaucoup d’alcools sup’ – avec des notes de chocolat amer, un peu brandy – et un autre qui a beaucoup d’esters – banane, ananas, etc –, tu obtiens un troisième élément en fonction des proportions.
Cela faisait des années que tu cherchais à acheter une distillerie dans les Caraïbes. Pourquoi ton choix s’est-il finalement porté sur West Indies, à la Barbade, rachetée en mars 2017 ?
Cela faisait huit ans que nous cherchions : si tu savais le nombre de distilleries que nous avons étudiées ! C’est pour ça que je les connais vraiment bien. Je suis tenu au secret, et je ne le trahirai pas, mais tu serais surprise des distilleries que j’ai auditées au fût près. C’était très enrichissant.
West Indies avait beaucoup de choses pour nous plaire. D’abord, une équipe de folie. Dario, qui s’occupe de la fermentation, c’est un prof universitaire qui s’est passionné pour le sujet. Andew, ingénieur en sciences de l’environnement qui gère la distillerie. Don, un de nos distillateurs depuis vingt ans, secondé par Digger qui est là depuis quarante ans… La liste est longue. Ensuite, du matos d’enfer, avec des alambics historiques, et notamment un Vulcain, un alambic à chambres du XIXe unique au monde.
 Peux-tu nous donner davantage de détails sur les alambics, extrêmement diversifiés ?
Peux-tu nous donner davantage de détails sur les alambics, extrêmement diversifiés ?
Bien sûr. West Indies a été le fournisseur de la British Navy pendant de longues années, et c’est l’une des expications à l’incroyable diversité de son équipement. Il y a donc le Vulcain à chambre du XIXe siècle que je viens de citer, acheté au début du XXe pour distiller notamment le rhum de la Navy. Il n’a pas de col-de-cygne, c’est comme des alambic empilés les uns sur les autres et il te fait un rhum hyper texturé. Le Greg Farm, un alambic à repasse du XIXe, acheté à la plantation du même nom début XXe. Les gens l’ont confondu pendant des années avec le Rockley. Le Rockley, justement, un petit alambic de la fin XVIIIe-début XIXe : il ne fonctionne pas pour l’instant, nous pensons le garder comme pièce de musée et le faire reproduire à l’identique. Et enfin le Batson, qui lui non plus ne fonctionne pas pour l’instant. Il a été acquis dans les années 1930 avec le rachat de la distillerie Batson. Les gens ici l’appellent le « Batson’s bitch » car il était semble-t-il très difficile et très technique à conduire. Nous pourrons le vérifier quand il sera réparé – nous y travaillons. Ensuite il y a les colonnes : la 77 John Dore, qui date des années 1970, une super colonne qui peut être rétrogradée en Coffey et permet de produire jusqu’à 12 types de rhum. On peut faire des rhums assez lourds avec cette colonne, c’est un truc à tiroirs, un truc de fou. Nous avons la grosse colonne 79 qui fait du rhum léger. Puis la Blair, une double colonne de 1945, installée à l’époque pour absorber les commandes croissantes de la British Navy. Celle-ci ne fonctionne pas à l’heure actuelle, il faut que je trouve des sous pour la réparer. Enfin, nous avons aussi une colonne à lies. Et tiens, j’ai un scoop pour toi : nous sommes en train de faire fabriquer, d’après de vieilles archives de la distillerie, un alambic à repasse John Dore de 20 hl, sans retort. Si tout va bien, il prendra la mer direction La Barbade dans deux mois.
WIRD était sous les radars avant que tu ne la rachètes, inconnue du grand public…
Cette image pas top de distillerie industrielle nous a bien rendu service parce que ça ne la valorisait pas. Les gens qui critiquent cette distillerie le font en parlant de la grosse colonne qui fait du rhum léger – West Indies est l’un des sites qui fabriquent du rhum pour Malibu. Mais derrière cette image, quel professionnalisme ! Chaque lot distillé est goûté toutes les quatre heures, une chromatographie est réalisée toutes les quatre heures également, le comité de dégustation se réunit tous les jours, et avant d’entrer dans la tasting room, chacun (moi y compris) doit passer un test à l’aveugle dans un sas isolé. Si tu te plantes, si tu ne reconnais pas les échantillons témoins de distillats qui sont différents chaque jour, tu ne rentres pas, même si tu es le propriétaire de la distillerie. Ça rend très humble.
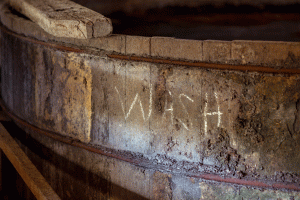
Une chose que l’on sait moins, c’est que quand tu rachètes West Indies à la Barbade, tu t’invites en même temps à la table du rhum jamaïcain.
Ça ne m’avait pas échappé, tu t’en doutes bien ! J’étais tellement surpris que West Indies ne soit pas courtisée. Parce que c’est une petite boîte, mais qui était cotée en bourse. Moi je n’avais jamais fait une OPA de ma vie. Et, là, les propriétaires me disent : « La boîte est cotée depuis 1901 donc good luck ! Nous on peut vous vendre nos parts, mais il faut que vous alliez acheter les autres. » Je te passe les détails. Je me suis dit : je vais avoir plein de concurrents. Mais comme cette distillerie n’avait pas de services marketing et ventes, personne ne la faisait briller, personne n’en parlait. Après le rachat, certains concurrents s’en sont mordu les doigts, quand ils ont su tout ce qui venait dans les cartons – les alambic, l’histoire, les stocks, les archives… Car West Indies, c’est des archives depuis 1893 de façon continue, avec des schémas de roue de distillation ou des courbes de chauffe du XIXe… C’est là qu’on a découvert des recettes de rhum fermenté à l’eau de mer, des recettes avec des dosages faits avec des mélasses… Des documents tellement importants que l’université de Kingston nous a demandé de tout enregistrer au musée.
Du rhum fermenté à l’eau de mer ?
C’est magique ! Le sel crée un petit stress sur les levures qui se développent alors complètement différemment. Selon Dave Wondrich, c’est quelque chose qui existait déjà en Jamaïque, où ils utilisaient un peu de sel de mer de temps en temps, mais à West Indies, l’eau de mer entrait dans certaines recettes dans des proportions assez importantes. Tu comprends, la distillerie est sur la plage – d’ailleurs, ils m’ont imposé d’acheter la plage. Alors j’ai une plage dans les Caraïbes. Et tu sais quoi ? Je ne m’y suis jamais baigné, en plus j’essaie de ne pas trop embêter les tortues qui viennent y pondre – parfois elles viennent jusque dans la distillerie, on va les remettre à l’eau. Bref, alors non, ça ne m’avait pas échappé que West Indies était propriétaire d’un tiers de stock jamaïcain. Mais quand je lis dans certains articles que j’ai mis la main sur « un tiers du conglomérat NRJ [National Rum of Jamaica, ndlr] »… NRJ n’est pas un conglomérat mais une société publique constituée par le gouvernement jamaïcain au moment où le rhum allait très mal, et qui a repris pour les sauver Long Pond, Innswood et Clarendon. Innswood a été fermée, on utilise le site pour faire vieillir les fûts aujourd’hui. Devant les difficultés, NRJ a fait appel à Demerara Distillers Ltd, au Guyana, et à West Indies, deux très anciennes distilleries de la région, qui ont pris chacune un tiers du capital. C’est un super partenariat et c’est tellement enrichissant… Tu imagines le petit pedzouille de Cognac qui se retrouve en Jamaïque avec un représentant du gouvernement, avec l’équipe de DDL? C’est le rêve ! Et puis Long Pond !
Long Pond était fermée, elle aussi…
Oui, depuis 2012. Mais en juillet 2017, on rouvre la distillerie en grande pompe, et c’est l’un des plus grands moments de ma vie. Ils avaient gardé un noyau dur de l’équipe pour s’occuper des muck pits, pour huiler la distillerie. Et presqu’un an après, un incendie se déclare. Ce jour-là, j’ai pleuré. Heureusement, les muck pits, véritable ADN de la distillerie, ont été sauvés et, après deux mois d’arrêt, on distillait de nouveau, on fait du ITP et des marks plus légères. On a perdu 90 foudres. On avait prévu d’organiser en mai la réouverture officielle de la salle de fermentation qui a brûlé, mais à cause de l’épidémie de coronavirus, tout est repoussé. Elle sera baptisée Winston Harrison Room, en hommage à un homme formidable, qui nous a beaucoup aidés pour rouvrir Long Pond, et qui est mort il y a quelques mois.
Long Pond vend tout son rhum en vrac. Toujours pas de marque à l’horizon ?
Si, il y aura bientôt un embouteillage Long Pond, un vieil ITP. Il a été reporté de quelques mois avec le décès de Winston. Depuis toujours, la quasi-totalité des Long Pond est en double vieillissement tropical/continental, mais là ce sera une expression 100% tropicale – pour moi l’une ne chasse pas l’autre. C’est cela la beauté du rhum, c’est cette merveilleuse diversité technique et gustative. Je sais qu’il y a un nouveau snobisme à dire il faut aller vers le tout tropical, mais à Long Pond, ça n’existe pas. Et chez Monymusk et Hampden, trois siècles d’histoire, c’est hyper récent.
Et du côté de Clarendon/Monymusk ?
Clarendon, c’est une vieille distillerie-sucrerie – la sucrerie s’appelait Monymusk – qui existe depuis le XVIIIe et qui a été remise complètement en état au milieu du XXe, pendant la deuxième guerre mondiale, un peu avant, un peu après, personne n’est sûr. On a toujours les alambics du milieu XXe, et il y a une dizaine d’années une multi-colonne a été ajoutée. Elle a une activité de vrac avec des high esters en fermentation longue – trois semaines –, comme Long Pond, sauf qu’à Long Pond on les fait avec des muck pits et pas à Clarendon. Et ça, pour un maître assembleur, c’est génial car ça me donne deux expressions complètement différentes des rhums lourds.
Un embouteillage sous marque West Indies à l’horizon ?
Absolument. Il sortira d’ici un an, un an et demi.
Un blanc ?
On va commencer par les rhums vieillis.
Tu t’es offert de quoi t’amuser pour 7 vies…
Oh, ça, c’est sûr ! Et j’ai eu de la chance, je le dis bien modestement. Créer une marque d’éleveur et se retrouver plongé dans la production de trois distilleries comme ça, c’est super. Et, en Jamaïque comme à la Barbade, il y a vraiment une très belle équipe. Mais en Jamaïque ce n’est pas moi qui leur dis : la coupe, on va la faire là. Parce que nous sommes vraiment trois associés, et on décide ensemble, c’est une approche collégiale.
Tu plaides inlassablement pour le respect de la diversité du rhum…
Oui, parce que le rhum est un produit vivant qui doit continuer à créer. Pour moi, derrière un grand rhum il y a un effort de création, de recherche de goût ultime. C’est drôle car on comprend l’importance des créateurs dans le parfum ou dans la gastronomie, mais on ne la comprend pas bien dans les spiritueux. Moi, si je ne peux plus créer, je me dessèche totalement. Je n’en peux plus d’entendre asséner que le rhum doit être comme ci ou comme ça et pas autrement.

Je me souviens pourtant d’une époque où tu me vantais les règles très strictes du cognac en me disant : « C’est une musique écrite, le défi est de s’exprimer dans ce cadre. » Si cela ne te pose pas de problèmes dans le cognac, pourquoi est-ce que cela t’en pose dans le rhum ?
Parce que j’ai évolué. En vieillissant, j’ai de plus en plus de mal avec les dogmes. Attention, je pense toujours qu’il faut des règles et des principes. Ma ligne de conduite pour Plantation tient en 4 points : 1) respect de la canne. Avec tout ce que cela entraîne : si tu distilles trop haut, tu ne respectes pas la matière première, par exemple. Si tu utilises du caramel, il faut que ce soit du caramel de canne, idem pour le sucre. 2) Transparence et honnêteté : fais ce que tu dis, dis ce que tu fais. Sur notre site, sur nos étiquettes à mesure qu’on les réimprime, on donne tous les détails possibles sur nos rhums. 3) Respecter et apprendre les techniques historiques du rhum et la diversité d’une île à l’autre, d’une distillerie à l’autre. 4) Rester ouvert à la création. Pour nous, tout est là.
Tu t’énerves souvent contre les gens qui, comme moi, écrivent que dans le rhum il y a peu de règles…
Parce que c’est faux ! Les textes sur le rhum existent en Europe, les règles du Caricom [Caribbean Community, ndlr], elles existent aussi, il suffit de les lire. Elles disent que l’origine du rhum, c’est là où il est fermenté, distillé. Elles disent que l’âge indiqué sur la bouteille est celui du plus jeune rhum, que le rhum doit être fait à partir de la canne, que si tu ajoutes un arôme, ça devient un rhum aromatisé, etc. Dans des tas de pays, Brésil, Venezuela, Guatemala…, le rhum doit suivre des règles. Quant à faire une règle commune sur le rhum, qui possède tant d’origines, c’est comme faire une règle commune sur le vin, comme si tu décrétais : à partir de maintenant, on utilise le pinot noir et c’est tout. Ça n’a pas de sens. En revanche, je suis favorable à ce qu’il y ait de grands principes à suivre. C’est pour ça que les règles du Caricom sont une bible. Mais je te rejoins sur une chose : en Europe ces cinq ou dix dernières années, des rhums venant de pays qui n’ont pas de règlement ont passé les frontières. Ce qui n’arriverait pas avec le whisky parce qu’il y a un gendarme, la Scotch Whisky Association. La différence, c’est que la SWA a des dizaines de millions de budget, alors que le budget de WIRSPA [West Indies Rum and Spirits Producers Association, ndrl], c’est 350.000€.
Le rhum de la Barbade et le rhum de la Jamaïque, pour prendre deux exemples que tu connais bien, sont suffisamment encadrés selon toi ?
Ce sont deux pays du Caricom et deux pays qui ont participé au Rum Standard, les règles qui en sont issues. Maintenant, ils veulent aussi établir une Indication Géographique (IG) et l’enregistrer auprès de l’Europe. Ce sera l’occasion de toiletter le Rum Standard.
Quand on dit que la Jamaïque et la Barbade n’ont pas le droit d’édulcorer le rhum…
Sur la Barbade, c’est une grosse connerie. Certains n’édulcorent pas, mais ce n’est pas interdit : West Indies utilise un peu de sucre de canne local pour certaines expressions. La Jamaïque a une réglementation très similaire, mais il y existe en plus un texte de douane qui a une vingtaine d’années et qui édicte que le rhum jamaïcain n’est pas sucré sur le lieu de distillation.
Quels sont les gros points d’achoppement sur les indications géographiques à la Barbade et en Jamaïque ?
Pour l’instant, avec l’épidémie, le débat est mis en sourdine, mais il reprendra. Les désaccords portent sur le type de bois, l’édulcoration, la nature des caramels, le vieillissement tropical ou double, et en Jamaïque la distillation 100% en alambics. La Jamaïque a déjà une IG nationale, version light, qui n’est pas enregistrée auprès de l’Europe. Nous sommes en train d’en rediscuter les contours, il ne faut pas se planter. Un exemple : le bois. Les projets d’IG Jamaïque et Barbade insistent sur les fûts de chêne. Or, le chêne n’est pas le bois le plus tropical, ce n’est pas ce qui pousse le plus au Caraïbes ! Alors, n’allons pas nous interdire les bois tropicaux ou d’autres bois durs européens qui étaient envoyés autrefois dans les îles, comme le frêne, le merisier, etc. On a découvert que parfois en Jamaïque on stockait les rhums en foudres de cèdre jamaïcain. Ça devait être un peu bizarre, mais tu te doutes bien que j’ai envie d’essayer.
Cela montre les limites d’une vision 100 % locale défendue par les puristes…
Ce n’est pas une vision puriste, c’est une vision restrictive. Les levures, pareil. Quand tu lis l’article 4 du cahier des charges de l’IG Jamaïque de 2016, les seules levures qui peuvent être utilisées doivent être de type Saccharomyces… ce qui interdit de facto les muck pits ! Car dans un muck pit, je peux te dire que toutes les levures ne sont pas de ce type. Les bactéries, ce sont des techniques anciennes. Le sucre et le caramel, également.
Il y a débat. Certains prétendent qu’on n’édulcorait jamais aux XVIIe-XVIIIe…
Admettons que cette phrase soit juste et que la pratique n’existe que depuis le début du XXe. C’est vrai qu’il y a peu de documentation dans un sens ou dans l’autre et qu’il y a des gens qui parfois isolent une phrase de son contexte. On n’a pas beaucoup de rhums anciens, mais quand tu goûtes des rhums de la fin XIXe, il y a une obscuration très importante.
Tu as toujours été un ardent défenseur de l’édulcoration, ce que toi tu appelles le dosage – au passage, bravo pour ce mot emprunté au champagne et au cognac, ça sonne mieux qu’édulcoration. Pourquoi ?
Parce que je prône le respect de la diversité des techniques et des rhums. Les gens qui refusent les additifs, ils savent ce que c’est le bois ou le finish dans le rhum ? C’est un additif ! Qui apporte des éléments organoleptiques, des tannins, de la couleur. Quand tu utilises un fût qui a contenu du sauternes et qu’il reste 3 % du vin dans les douelles, tu vas me dire que ce n’est pas un additif, nom de bleu ?
Le vieillissement, c’est un peu plus complexe que ça. C’est un phénomène additif, mais également soustractif…
Ça ne change rien. Mais pourquoi je défends le dosage… Les gens s’imaginent qu’on renverse un sac de sucre comme ça, dans le fût de rhum. Mais non ! Nous alcoolisons nos sucres, d’origine locale à chaque fois que c’est possible, nous les faisons vieillir en fûts pour qu’ils soient complètement intégrés, et nous les utilisons en quantité infinitésimale. C’est d’ailleurs prévu par le règlement européen qui intègre et respecte cela. En outre, je suis pour qu’on pose une limite : 20g de sucre par litre maximum – c’est moins de 0,6g par verre [le nouveau règlement européen UE 2019/787, approuvé au printemps 2019, est venu entériner ces 20g/l, ndlr]. Pourquoi ? Parce que les rhums sont de plus en plus légers, or, si tu veux travailler sur le dosage, il faut le faire avec des rhums très texturés. Et pas systématiquement, car certains rhums sont délicieux travaillés ainsi, et d’autres surtout pas. J’utilise





